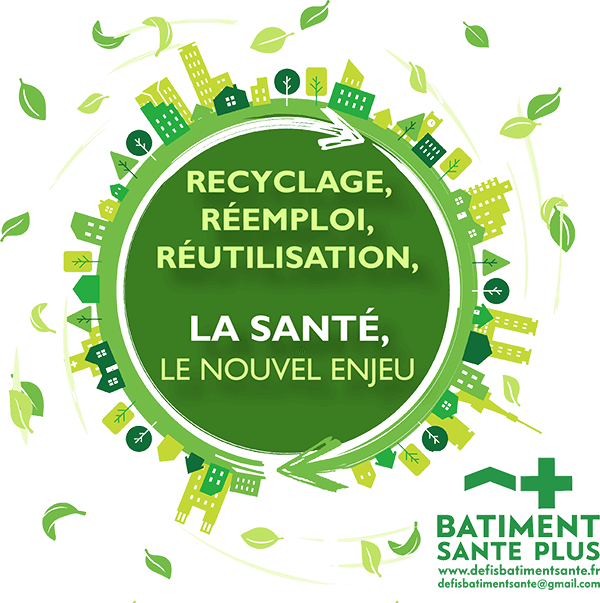Corinne LANGLOIS
Corinne LANGLOIS
Architecte et urbaniste en chef de l'Etat, Sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie
Ministère de la Culture
L’architecte, le meilleur allié de la santé dans le bâtiment grâce à sa vision globale et son approche par l’usage
Corinne Langlois, après avoir obtenu votre diplôme d’architecte et suivi la formation de l’École de Chaillot dans les années 80, vous avez dédié une partie de votre carrière à la restauration du patrimoine, notamment comme Architecte des Bâtiments de France en Dordogne. Le sujet « santé » était-il déjà abordé et comment ?
Quand on travaille sur les questions de patrimoine, on se préoccupe de la transmission d’une génération à l’autre, de l’ancrage civilisationnel. Certes, cela ne concerne pas la santé physique, mais c’est un volet très important qui touche à la capacité sociale et culturelle des individus, à leur lien avec un territoire et entre générations, aux émotions et au comportement … On se projette mieux dans l’avenir quand on sait d’où l’on vient, c’est une dimension qui répond aux besoins psychosociaux de l’être humain.
De façon très pragmatique, quand on travaille sur le patrimoine, c’est parfois sur des bâtiments très dégradés, où il ne s’agit même pas de questions de santé mais de sécurité ! Même sans aller jusqu’aux situations où les structures de bâtiment sont en péril, quand j’ai commencé ma carrière, dans les années 90, j’ai été sensibilisée aux questions de santé et de sécurité sur le chantier. Par exemple, les couvertures des édifices anciens majeurs contiennent souvent du plomb dont l’impact sur la santé nous interrogeait notamment pour les compagnons. Les monuments historiques sont souvent imposants. La sécurité et la santé sur le chantier prend un sens particulier du fait de leur ampleur : tomber d’un toit de pavillon ou de celui d’une cathédrale n’a pas les mêmes conséquences. Même si nous travaillons avec des compagnons très spécialisés, ils avaient alors du mal à intégrer ces contraintes basiquement physiques. Aujourd’hui, cela a beaucoup changé et heureusement ! C’est aussi une typologie de chantiers où les risques pour les riverains peuvent être importantes et doivent aussi être largement prises en compte. Dans les années 90, l’émergence du métier de coordinateur sécurité et salubrité est venue répondre à ces préoccupations, mais elles étaient déjà bien présentes.
Au-delà des grands monuments, vous avez aussi eu en charge des centres villes anciens, avec un patrimoine vernaculaire, parfois habité. Comment était abordée la santé dans ces projets moins prestigieux ?
J’étais en Dordogne qui est un département assez défavorisé. Certaines situations à Bergerac ou à Périgueux m’ont amenée à travailler sur des situations d’habitat indigne, ce qui n’est pas l’entrée première du métier d’ABF. Je ne pouvais pas imaginer préserver l’aspect d’un immeuble qui masquait des logements tellement dégradés que les habitants y étaient en danger ou dans des situations d’inconfort extrême. Dans ce cadre, j’ai travaillé avec l’ARS, la Direction de la protection des populations et le Conseil départemental. Nous avons géré des situations assez lourdes avec des habitants qui n’osaient plus sortir de chez eux car leurs conditions de vie ne leur permettaient pas d’être propres et d’avoir une vie sociale. La prise en compte de la santé dans le logement d’une manière globale, c’est aussi garantir cette dignité de vie qui est fondamentale dans le rapport aux autres.
Vous avez aussi été directrice générale adjointe de l'agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine a'urba. Comment décliner les questions de santé quand on passe à l’échelle du quartier ou de la ville ?
Comme j’étais en lien avec l’ARS pour avoir déjà mené des projets avec elle, elle nous a demandé de réfléchir aux modalités d’intégration de la dimension santé dans les documents d’urbanisme. Le travail que nous avons mené avec Bob Clément – NDLR, Urbaniste de l’a’urba, travaillant notamment sur l’approche de l'urbanisme par la qualité de vie et l’urbanisme favorable à la santé – et une équipe d’architectes, sociologues et spécialistes des questions de services, se situait aussi dans le cadre du projet politique de Bordeaux Métropole, une métropole sensible et solidaire, puis une Métropole de la haute qualité de vie. Comment traduire concrètement de projet politique en aménagement ? C’est sur le développement de méthodes que nous avons travaillé.
Il n’est pas évident d’introduire la problématique de la santé dans l’aménagement urbain. Et de bien comprendre que soins et santé, ce n’est pas la même chose ! Pour cela, on s’est beaucoup intéressé aux questions sensibles pour les rationaliser : nous avons fait le choix de ne pas travailler sur des solutions immédiates à proposer mais de repartir des fondamentaux : en quoi les sens influencent-ils nos comportements et notre sensibilité ? Nous avons adopté une approche à partir des sciences cognitives, comment on voit, on entend, on goûte… À partir de quels capteurs, peut-on qualifier cela et comment cette association se traduit en émotions ? Nous avons ainsi conçu une promenade sensible pour permettre de faire des expériences en isolant la perception de chaque sens pour mieux qualifier l’espace et identifier les ressentis : par exemple, quand on fait ne serait-ce que 50 mètres les yeux fermés en ne pensant qu’à ses pieds, on se rend compte des irrégularités, des instabilités des surfaces… sans aucune comparaison avec la situation ordinaire de marche. Cet apprentissage est d’une efficacité redoutable pour faire prendre conscience aux habitants, aux élus et aux techniciens de tout ce qu’ils ne perçoivent pas et qui doit pourtant être pris en compte, notamment dans l’aménagement des espaces publics pour qu’ils soient agréables pour tous.
Une fois la prise de conscience réalisée, quelles sont les freins qui subsistent pour une meilleure prise en compte des dimensions santé et confort ?
Une des difficultés réside dans l’évaluation et l’harmonisation des critères. Qu’est-ce que cela veut dire la qualité de vie ? On ne peut pas avoir une approche fonctionnelle, la qualité de vie ne se décrète pas, nous sommes sur des questions de sensibilité. Il faut donc croiser l’ensemble des critères, prendre en compte l’imaginaire, le récit individuel et collectif… la qualité de vie n’est pas perçue de la même façon selon le contexte socio-économique. Elle ne dépend pas des mêmes critères à Lille et à Marseille. Il faut travailler sur des approches multicritères et les hiérarchiser selon le contexte pour bien piloter un projet urbain sous cet angle.
Un autre frein est représenté par la logique adoptée par les différentes réglementations sanitaires. Toutes définissent un seuil d’alerte, un minimum en-deçà duquel il ne serait pas tolérable de descendre. Cela rend difficile l’approche qualitative : on ne peut pas s’appuyer sur le seul respect de la norme pour dire qu’un bâtiment est bien conçu pour la santé. Alors comment faire ? Et dans un contexte où les normes sont multiples sur différents sujets, les acteurs ne prennent pas toujours l’habitude de les dépasser. D’ailleurs, lorsque nous avons travaillé sur l’intégration de la santé dans les documents d’urbanisme, une de nos préoccupations a été l’approche à adopter afin que nos recommandations soient bien accueillies et évitent un rejet du « quelque chose encore en plus » pour les services des collectivités. On a donc opté pour une démarche partant des actions qu’elles faisaient déjà, leur proposant d’évaluer leurs impacts sur la santé et de choisir celles qu’elles pouvaient renforcer pour améliorer la santé des habitants au quotidien sans forcément avoir à créer de nouvelles actions.
Enfin, il est important de bien chaîner les différentes étapes : dans beaucoup de collectivités, il y a un travail sur une partie de la chaîne mais pas sur toute : il faut d’abord des axes stratégiques, ensuite des services pour les mettre en œuvre et enfin des outils financiers et réglementaires. Si on oublie une de ces facettes, la politique publique prendra beaucoup d’énergie mais risque d’être peu efficace.
Le projet de guide sur lequel vous avez travaillé à Bordeaux était local. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Ce travail a posé les prémices du guide ISadOra, publié début 2020 et réalisé par l'École des Hautes Études de Santé Publique et l'Agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine a'urba, avec le soutien de l'ADEME, de la DGALN et de la DGS. Ce guide aborde les aspects concrets du projet, le portage des politiques publiques de territoires… C’est très long de faire émerger tout cela, de sensibiliser les acteurs sur le fait que l’homme fait partie de son environnement et qu’il faut agir sur la dimension santé de manière bien plus approfondie que les seules contraintes réglementaires. C’est une très belle réussite de l’équipe de l’a-urba qui a réussi à produire cet ouvrage !
Abordons maintenant l’actualité : les impacts de la crise sanitaire sur l’évolution de la prise en compte de la santé peuvent-ils déjà être imaginés ? On peut penser par exemple aux difficultés d’adaptation au télétravail notamment, qui efface la frontière entre le travail et la vie personnelle, parfois dans des appartements de toute petite taille ?
En premier lieu, ce qui va nous revenir en boomerang et dont nous ne connaissons pas encore les effets, ce sont les impacts d’ordre psychologique. Ce sera long d’identifier les conséquences réelles sur la santé de cette crise et des confinements.
Ensuite, il ne faut pas oublier que les architectes sont très innovants. Ils font beaucoup de R&D et ils travaillent déjà sur ces notions du travail chez soi, de l’accès à un espace extérieur, etc. depuis plusieurs années. Il y a d’autres sujets qui ont été soulevés par le confinement, et qui sont déjà anciens : par exemple, la garde alternée. Quel logement doit-on avoir quand on est deux une semaine et cinq la suivante ? Les besoins en matière de logements évoluent beaucoup au cours de la vie. Une étude a recensé jusqu’à quinze logements différents nécessaires pour répondre de manière idéale à toutes les étapes d’une vie. Il faut donc travailler sur des logements plus évolutifs, plus malléables. C’est un vrai enjeu, bien au-delà du télétravail.
La question qui se pose est aussi sociologique. Être bien dans son environnement bâti dépend de trois niveaux : d’abord, de son intimité, chez soi, en famille, ensuite, des espaces de familiarité, avec les voisins, par exemple du hall de l’immeuble. On n’est pas forcément intime avec les gens qu’on croise mais on connaît leur nom, leur visage… Enfin, le troisième niveau est l’extérieur qui permet une vie sociale. Les individus qui ne peuvent pas avoir accès à ces trois niveaux vont avoir plus de difficultés à s’intégrer dans la société. La qualité de l’habitat ne se limite donc pas au bâtiment stricto sensu. On parle notamment de la ville du quart d’heure, c’est-à-dire d’une conception de l’urbanisme qui prenne en compte les services et activités diverses que toute personne peut avoir dans un rayon d’environ un kilomètre. Cette notion a été mise en lumière avec le confinement, mais ces réflexions existaient bien avant chez les architectes.
Ensuite, c’est fondamental que le bâtiment ne soit pas pathogène, n’expose pas à des substances nocives, etc. Mais la prise en compte de la santé doit aller bien au-delà.
Cette année, la thématique des Défis Bâtiment Santé concerne l’économie circulaire et soulève notamment la question du recyclage et réemploi des matériaux dont les critères sanitaires n’ont pas toujours été évalués. Comment les architectes se positionnent-ils vis-à-vis de ce sujet émergent ?
Les architectes travaillent depuis longtemps pour limiter les déchets. Il ne faut pas oublier que le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! Ils travaillent donc d’abord à transformer l’existant, l’adapter et éviter de le démolir. On retrouve la notion de bâtiment évolutif en fonction des besoins et des étapes de vie.
Pour construire, ils font souvent appel à des circuits courts. Beaucoup utilisent le chanvre, le bois, la terre, la paille… dans une logique de proximité. Il faut créer des cycles vertueux, valoriser les territoires par leurs ressources : nous travaillons sur ces sujets, par exemple, avec les Parcs naturels régionaux. De nouvelles certifications sont nécessaires pour renforcer la dynamique de ces matériaux.
Bien sûr, ils peuvent utiliser aussi des matériaux recyclés, mais il ne faut pas oublier : les architectes engagent fortement leur responsabilité professionnelle sur les projets qu’ils conduisent. Ils sont donc très sensibles à la qualité des matériaux qu’ils utilisent. Les contrats d’assurance les encouragent à la prudence et ce aussi sur les risques sanitaires. Ils sont enfin force de proposition lorsque les situations ne sont pas optimales. Par exemple, lorsque par souci de performance thermique, on a créé des logements bouteilles thermos, les architectes ont très vite alerté sur les impacts sur le confort de vie des recommandations faites aux occupants de ne pas ouvrir leurs fenêtres et sur les risques sanitaires liés à l’absence du changement régulier des filtres des systèmes de ventilation double flux.
Cela permet de faire la transition avec une autre actualité : la RE 2020. Des voix regrettent la faible prise en compte de la santé.
Au sein de la RE 2020, réduire l’impact environnemental des bâtiments neufs, en contrôlant leur empreinte carbone dès leur construction, tracer les matériaux qui seront utilisés ou encore améliorer le confort des habitants, en adaptant les logements au nouveau climat, comme les épisodes de forte canicule, sont des façons transversales de porter attention à la santé des usagers. On peut s’en réjouir, cependant, dès qu’une politique est très technique, ce qui est le cas de la RE 2020, cela a toujours des effets de (trop grande) simplification. Nous, ce qu’on traite, c’est la complexité, la qualité architecturale et notamment l’intégration des usages. Ce n’est pas une démarche qui se mesure facilement ! Et donc, il est difficile de l’intégrer dans une réglementation contrainte. La dimension humaine et le ressenti nécessitent des modes d’évaluation complexes à mettre en œuvre car il n’y a pas d’éléments chiffrés. Il faut alors admettre qu’on peut se tromper, prévoir des phases d’expérimentation qui peuvent être longues.
A ce jour, il y a des initiatives d’évaluation au niveau local, dans certaines collectivités. Produire un protocole d’évaluation au niveau national demanderait une harmonisation de critères très qualitatifs et donc peu adaptés à une standardisation… L’Agence Française de Développement a recensé plus de 50 méthodologies permettant d’évaluer l’impact d’un projet urbain sur la qualité de vie ! Et c’est un sujet sur lequel on ne peut pas faire de tests en labos sur un petit échantillon. Il faut prendre en compte le retour des usagers sur le long terme. Des indicateurs simples sont par exemple le taux de vacance des logements et des bureaux, les dysfonctionnements urbains et comportementaux, les rotations des locations, la valeur foncière… En général, quand les occupants restent très longtemps au même endroit et que la valeur foncière grimpe, c’est que la qualité de vie n’est pas trop mauvaise. Les bailleurs sociaux utilisent ce type d’indicateurs, mais ils sont peu partagés par d’autres acteurs.
Enfin, une des voies de progrès, ce sont les labels : le label pousse vers la qualité. Mais il manque un label intégrateur, qui prendrait en compte l’ensemble des critères.
Plus spécialement, quels sont les axes de travail du Ministère de la Culture et le rôle des architectes ?
Sur ces sujets, nous accentuons la formation dans les écoles d’architecture généralistes, nous soutenons des chaires partenariales de recherche, et particulièrement la chaire partenariale « Architecture, Design, Santé » (ARCHIDES) dont les membres fondateurs sont : l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris - APHP, l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val de Seine, le laboratoire l’EVCAU, l’École Camondo et la Fondation de l’AP-HP pour la Recherche, fondation hospitalière, dédiée au soutien à la recherche en santé.
Le questionnement autour des méthodes pour vérifier l’impact de certains matériaux sur la santé se pose de plus en plus dans l’enseignement et la recherche en architecture, mais il faut surtout souligner le rôle de l’architecte sur tout ce qui est immatériel et sensible. Certes, il doit respecter des normes techniques d’éclairement, de ventilation, de niveau acoustique… mais son cœur de métier n’est pas que là, il consiste à créer des espaces de vie confortables, à intégrer la finalité, les usages, la qualité de vie. Sa valeur ajoutée s’exprime dans ses choix de conception, qui vont être la clé pour proposer des solutions nouvelles intégrant, dans une approche globale, non seulement la meilleure utilisation possible des composantes normées du bâtiment mais aussi toutes les dimensions sensibles : couleurs, ambiance, orientation…
Le métier de l’architecte, ce n’est pas de produire le bâti en soi mais l’usage qui va en être fait au quotidien et les émotions positives qu’il va générer.
Interview du 7 décembre 2020 réalisée par Marie Bérenger de Kita Organisation pour Bâtiment Santé Plus

Architecte et urbaniste en chef de l'Etat, Corinne LANGLOIS est diplômée de l’École d’Architecture de Paris-Villemin (désormais Paris Val de Seine) avec les félicitations du jury et de l’École de Chaillot. Architecte libérale pendant une dizaine d’années à Blois, elle a ensuite rejoint les services déconcentrés de l’État, en Dordogne, comme ABF, puis comme responsable de l’unité territoriale du Bergeracois et enfin comme chef du service Habitat Construction. Entre 2011 et 2018, elle est directrice générale adjointe de l’Agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (a'urba) où elle travaille, en particulier, sur les thématiques habitat et production du logement, nature et ville, patrimoines, santé environnementale et ville sensible. En mars 2018, elle est nommée Sous-directrice de l'architecture, de la qualité de la construction et du cadre de vie au Ministère de la Culture.